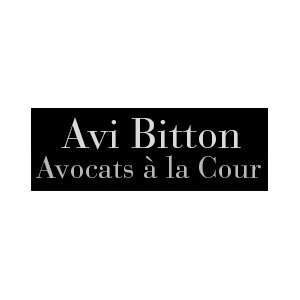Fondé en 2012 par Me Ahlem NESSAH, le cabinet intervient principalement en droit des étrangers et de la nationalité. Face à des réglementations complexes et en constante évolution, le recours à un avocat en droit de l’immigration se généralise.
L’expertise de Me NESSAH est reconnue pour toutes les questions liées à l’entrée, à la protection et au séjour des ressortissants étrangers.
Elle conseille, assiste et défend ses clients, notamment dans le cadre des démarches et procédures juridiques suivantes :
- Demandes de titres de séjour : constitution du dossier de régularisation administrative et assistance en préfecture,
- Recours contre les mesures d’éloignement : obligation de quitter le territoire (OQTF), interdiction de retour (IR), arrêtés d’expulsion, décisions de transfèrement (Dublin),
- Personnes retenues aux fins de vérification du droit au séjour,
- Placement en rétention administrative, vérification d’identité, garde à vue, garde à vue,
- Regroupement familial,
- Travail des étrangers,
- Demandeurs d’asile : préparation de l’entretien à l’OFPRA, assistance devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA),
- Contentieux des visas,
- Demande de délivrance d’un certificat de nationalité française,
- Recours contre les décisions refusant ou différant des demandes de nationalité française.
À propos de ANKH CABINET
Fondé en 2012
50 personnes dans l'équipe
Domaines de pratique
Langues parlées
Gratuit • Anonyme • Avocats Experts
Besoin d'un accompagnement juridique personnalisé ?
Mettez-vous en relation avec des avocats expérimentés près de chez vous pour obtenir un conseil adapté à votre situation.
Aucune obligation d'embauche. Service 100% gratuit.
Domaines de pratique
Immigration
AVOCAT EN DROIT D'ASILE
Droit des étrangers et de l'immigration
Me NESSAH, avocate en droit d'asile, assiste les personnes ayant quitté leur pays parce que leur vie et leur intégrité physique ou mentale sont menacées, dans la procédure de demande d'asile.
Après le dépôt d'une demande d'asile et la réception par l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides), cet organisme décide de vous accorder le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.
L'OFPRA reconnaît le statut de réfugié ou octroie la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions définies par le droit national ou international, notamment s’agissant de la notion de persécution. Faute de preuves suffisantes, l'OFPRA refuse fréquemment de vous accorder le statut ou la protection.
Me NESSAH, avocate en droit d'asile, sera un interlocuteur privilégié tout au long de la procédure. Que ce soit lors de votre entretien à l'OFPRA ou devant la Cour nationale du droit d'asile qui juge en premier et dernier ressort, sous le contrôle du Conseil d'État, juge de cassation.
Préparation de l’entretien à l’OFPRA
Lorsque le dossier de demande d'asile est enregistré, une lettre est adressée au demandeur d'asile. Ce document est essentiel pour le demandeur d'asile puisqu'il contient son numéro de dossier et lui permet d'obtenir un récépissé de la préfecture valable six mois puis renouvelable tous les trois mois pendant la durée de la procédure d'asile.
L'Office convoque chaque demandeur à un entretien, sauf exceptions énumérées par la loi. L'entretien a pour objet de permettre au demandeur d'asile d'exposer pleinement les raisons de sa demande, de compléter ou de rectifier son récit écrit et de préciser d’éventuelles zones d'ombre.
Les questions de l'agent de protection visent à obtenir une vision complète des faits vécus par le demandeur ainsi que des motifs de ses craintes. Les déclarations orales du demandeur et ses réponses aux questions posées constituent l’un des éléments essentiels pour apprécier, lors de la phase d'instruction, le bien-fondé des craintes de persécution.
Cet entretien se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète.
Les déclarations orales sont consignées dans un compte rendu quasi-verbatim sur un formulaire mentionnant notamment la durée de l'entretien et comportant également des rubriques administratives relatives à la situation des membres de la famille du demandeur.
Me NESSAH, avocate en droit d'asile, vous prépare et vous assiste lors de cet entretien.
Recours contre les décisions de l’OFPRA
Les décisions de l'OFPRA peuvent faire l'objet d'un recours. Trois types de décisions de l'OFPRA peuvent être contestées et faire l'objet d'un recours écrit par un avocat devant la Cour nationale du droit d'asile :
- Le rejet d'une demande d'asile,
- Une décision de protection subsidiaire lorsque le demandeur estime que ses craintes en cas de retour sont liées à l’un des motifs prévus par la Convention de Genève et qu'il devrait donc bénéficier du statut de réfugié,
- Les décisions de cessation ou de retrait de la protection.
Veuillez noter : les décisions de l'OFPRA relatives au rejet d'une demande d'apatridie ou à un refus d'enregistrement d'une demande d'asile peuvent également faire l'objet d'un recours. La juridiction territorialement compétente est le tribunal administratif de Melun.
Délais de recours
Un demandeur d'asile résidant en France métropolitaine dispose d’un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA pour introduire un recours devant la CNDA.
Un demandeur d'asile résidant outre-mer bénéficie d’un délai supplémentaire d’un mois, soit 2 mois à compter de la notification de la décision de l'Office, pour former un recours devant la CNDA.
Me NESSAH, avocate devant la Cour nationale du droit d'asile, vous représente devant la Cour.
Veuillez noter : la date de notification par l'OFPRA correspond à la date à laquelle le demandeur a reçu la réponse de l'OFPRA par lettre recommandée avec avis de réception ou à la date à laquelle le facteur établit un avis de passage si le courrier n'a pas été retiré.
Si une demande d'aide juridictionnelle a été déposée avant la transmission du recours, celle-ci interrompt le délai de recours. Dans ces conditions, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Les éléments nécessaires à la constitution d’un recours
Un demandeur d'asile résidant en France métropolitaine dispose d’un mois après la notification de la décision de l'OFPRA pour introduire son recours devant la CNDA. Pour les demandeurs d'asile résidant outre-mer, le délai de recours est porté à deux mois.
Le recours adressé à la CNDA doit être rédigé en français et contenir les informations suivantes :
- Noms et prénoms du demandeur d'asile
- Date et lieu de naissance
- Nationalité
- Adresse domicile
- Copie de la décision de l'OFPRA
Une lettre exposant l’objet de la demande et les arguments de fait et de droit invoqués par le requérant pour contester la décision de l'OFPRA. Le recours doit donc être motivé et signé par le demandeur d'asile ou son avocat. Le requérant peut joindre des pièces pour étayer son récit.
L’audience à la CNDA
Lorsqu'une affaire est inscrite à l’audience, la Cour convoque les parties. Plusieurs affaires sont évoquées au cours de la même audience. Les listes des dossiers traités sont affichées sur la porte de chaque salle d’audience.
Quand une affaire s’avère sensible, Me NESSAH, avocate en droit d'asile, sollicite systématiquement auprès du président de la formation de jugement que le débat se déroule à huis clos.
Après l’appel du dossier par le greffier, le président donne la parole au rapporteur qui procède à la lecture de son rapport. Ce rapport mentionne les éléments nécessaires à l’éclairage du débat sans préjuger du sens de la décision.
Les principaux éléments du rapport sont traduits au demandeur par l’interprète.
Ensuite, les trois membres de la formation de jugement peuvent poser des questions au demandeur, qui peut être assisté par un interprète si nécessaire. Ce n’est qu’en fin d’audience que l’avocate en droit d’asile est invitée à présenter des observations orales, bien qu’elle puisse cependant demander expressément à les formuler avant la phase des questions posées à son client.
Enfin, le représentant de l'OFPRA, lorsqu’il est présent, peut à son tour présenter des observations.
Le sens de la décision est affiché dans l’enceinte de la Cour environ trois semaines après l’audience. Le jugement est ensuite notifié aux parties par courrier recommandé avec avis de réception.
La formation de jugement peut :
- Annuler la décision de l'OFPRA : dans ce cas, le demandeur d’asile obtient une protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire).
- Rejeter le recours du demandeur d’asile : dans ce cas, le demandeur peut se pourvoir devant le Conseil d’État (avec un avocat spécialisé).
- Annuler la décision de l'OFPRA avec renvoi de l'examen du dossier à l'Office en cas de violation d'une garantie procédurale essentielle du droit d'asile (absence d'entretien).
Défense pénale
DROIT PÉNAL DES AUTEURS
Droit pénal des personnes physiques ou morales
Me NESSAH, avocate pénaliste des Auteurs, intervient 7 jours sur 7, depuis l’ouverture des poursuites pénales jusqu’au jugement. Un numéro d’urgence est mis à disposition et disponible sur cette page.
LA GARDIENNAGE
En droit pénal, la garde à vue est définie comme une mesure de contrainte par laquelle un officier de police judiciaire (gendarme ou policier) retient une personne qui, pour les besoins de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.
Une personne ne peut être placée en garde à vue que s’il existe des éléments de fait plausibles la laissant soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
La durée de la garde à vue
La durée de la garde à vue est de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures ou de 48 heures maximum, avec l’autorisation du Procureur de la République.
Cependant, pour les affaires de stupéfiants, de criminalité organisée et de terrorisme, la durée peut atteindre 96 heures.
Les droits des personnes en garde à vue
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée :
- de la nature de l’infraction faisant l’objet de l’enquête,
- des dispositions relatives à la durée de la garde à vue,
- Elle doit bien entendu être informée de ses droits, à savoir :
- le droit de faire prévenir par téléphone la personne avec laquelle elle vit habituellement, sa famille ou son employeur,
- le droit d’être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République. À défaut de demande formulée par la personne, un membre de sa famille peut demander un examen médical,
- le droit de s’entretenir avec un avocat de son choix dès la première heure de garde à vue. Cet entretien est confidentiel et ne peut excéder 30 minutes.
Me NESSAH, avocate pénaliste, sera présente dès le début de la mesure de garde à vue et pendant toute la durée de votre garde à vue (auditions et interrogatoires).
La fin de la garde à vue
Au terme de cette garde à vue, plusieurs hypothèses sont possibles :
- la personne est remise en liberté,
- la personne est convoquée par un officier de police judiciaire pour une audition à venir (COPJ),
- la personne est déférée devant un Magistrat (Juge des Enfants ou Juge d’Instruction et éventuellement Juge des Libertés et de la Détention) : jusqu’au procès, la personne est alors placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire avec obligations à respecter.
IMPORTANT
Si un proche ou un membre de votre famille est déféré à l’issue de sa garde à vue, il existe un risque important de comparution immédiate et/ou d’incarcération.
Afin de nous permettre d’agir dans l’intérêt supérieur de la personne gardée à vue, il est essentiel de nous communiquer, très rapidement, les documents nous permettant de l’aider (contrat de travail, bulletin de salaire, livret de famille, etc.).
COMPARUTION IMMÉDIATE / TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Le cabinet ANKH vous assiste lors de l’audience de comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel afin de vous défendre au mieux de vos intérêts. Si les amendes sont jugées par le tribunal de police, le Tribunal correctionnel est une juridiction de jugement, rattachée à la Cour d’appel, qui statue exclusivement en matière pénale.
Cela signifie que le Tribunal correctionnel juge les infractions dites délits commises par des majeurs poursuivis en tant qu’auteurs de l’infraction, coauteurs de l’infraction ou complices de l’infraction. Devant le Tribunal correctionnel, les personnes poursuivies sont appelées « prévenus ».
Le Tribunal correctionnel juge en formation collégiale ou « juge unique ».
Les audiences du Tribunal correctionnel statuant « à juge unique » concernent les affaires les moins graves (comme par exemple les contraventions au Code de la route) lorsque la peine encourue est inférieure à 5 ans d’emprisonnement. C’est également un juge unique du Tribunal correctionnel qui valide votre peine lorsque vous comparaissiez dans le cadre de la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité ou « CRPC ».
La formation collégiale du Tribunal correctionnel est composée de :
- trois magistrats professionnels : un président et deux assesseurs (au lieu d’un président seul pour le juge unique),
- un représentant du Ministère public appelé le Procureur de la République,
- un greffier
Les débats se déroulent normalement en présence du public.
La procédure devant le Tribunal correctionnel se déroule comme suit :
- Le président enregistre l’identité et l’adresse du prévenu et l’informe de l’infraction dont il est accusé
- Le président interroge le prévenu
- Les avocats des parties civiles plaident ou la partie civile réclame réparation du préjudice subi
- Le Procureur de la République présente ses réquisitions : demande de réparation du dommage causé à la Société
- L’avocat du prévenu plaide dans l’intérêt de son client.
IMPORTANT
En tant que prévenu devant le Tribunal correctionnel, vous avez toujours la parole en dernier ressort.
Le jugement de votre affaire est rendu soit « sur le banc » (c’est-à-dire immédiatement), soit « en délibéré », (généralement le jour même après une suspension d’audience ou à une date ultérieure indiquée par le président).
En tant que prévenu, vous pouvez interjeter appel de ce jugement devant la Cour d’appel. Le Procureur de la République et la partie civile peuvent également faire appel de ce jugement.
Le Tribunal correctionnel peut notamment prononcer à votre encontre :
- une amende,
- une ordonnance de réparation au profit de la partie civile,
- une suspension de votre permis de conduire pour une durée déterminée,
- une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans (sauf en cas de récidive légale où la peine peut être portée à 20 ans).
Il convient de noter que la peine d’emprisonnement à laquelle vous êtes condamné peut être aménagée avec ou sans sursis. Dans ce cas, si vous ne commettez pas de nouvelle infraction pendant la durée de votre sursis, vous n’exécutez pas cette peine.
Que vous soyez convoqué dans le cadre d’une audience « à juge unique » ou en formation collégiale, Me NESSAH vous prépare à votre comparution et défend vos intérêts devant le Tribunal correctionnel.
Pour cela, Me NESSAH recherchera d’abord les nullités de la procédure permettant de demander au tribunal votre mise en liberté :
- notification des droits en garde à vue,
- exercice des droits en garde à vue,
- notification au parquet, etc.
Il s’agit principalement de nullités résultant du non-respect des règles de procédure en matière pénale.
Me NESSAH mettra tout en œuvre pour obtenir votre relaxe, votre mise en liberté, votre acquittement ou une peine tenant compte de votre personnalité et de votre degré de participation dans la commission de l’infraction.
En effet, en l’absence de nullité, nous constituerons un dossier permettant de réduire considérablement votre peine. Pour cela, il est essentiel de nous transmettre, très rapidement, des documents nous permettant de vous défendre au mieux de vos intérêts (contrat de travail, bulletin de salaire, livret de famille, etc.).
L’ENQUÊTE ET L’INSTRUCTION
L’enquête suit généralement votre placement en garde à vue. Elle relève de la compétence exclusive du juge d’instruction. Il convient de noter que si vous êtes mineur, vous pouvez être mis en examen par un juge d’instruction mais également par un juge des enfants (exerçant ainsi les fonctions d’un juge d’instruction : lorsque les faits qui vous sont reprochés sont simples).
La mise en examen vise la personne à l’encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants laissant présumer qu’elle a pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction.
Vous bénéficiez de nombreuses garanties dès la mise en examen :
Comparution en présence de votre avocat pour un interrogatoire appelé examen de première comparution ou « IPC ». Lors de cet interrogatoire, le magistrat
vérifie votre identité et votre adresse et vous demande d’expliquer les infractions dont vous êtes accusé,
Droit de garder le silence, de répondre aux questions du juge d’instruction ou de faire des déclarations spontanées.
Vous pouvez également être convoqué à ce premier interrogatoire par lettre recommandée ou par un officier de police judiciaire. Vous êtes alors libéré de votre placement en garde à vue et vous comparaîssez ultérieurement devant le juge d’instruction. Ce type de convocation est fréquemment utilisé pour les affaires assez simples relevant de la compétence du juge des enfants.
À l’issue de votre examen de première comparution, le juge d’instruction peut décider de vous mettre en examen ou de vous accorder le statut de témoin assisté (statut intermédiaire entre celui de mis en examen et de simple témoin).
Il décide alors de vous faire comparaître devant le Juge des Libertés et de la Détention qui peut décider de vous placer :
- sous contrôle judiciaire (obligation de se présenter régulièrement au commissariat),
- en détention provisoire (il s’agit d’une incarcération pour une partie ou la totalité de la durée de l’instruction de votre dossier).
Me NESSAH, avocate pénaliste, après avoir consulté votre dossier et en avoir discuté avec vous, vous rappelle vos droits, veille à leur respect et vous assiste pendant toute la durée de votre mise en examen.
L’instruction, suite à la mise en examen, est une phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d’instruction est chargé de réunir les preuves sur la commission d’une infraction.
Au cours de l’instruction, vous disposez de droits. En particulier, vous pouvez demander des pièces :
- restitution des objets qui vous appartiendraient et qui seraient placés sous scellés,
- demandes de mise en liberté,
- demandes d’auditions,
- demandes d’expertise ou de contre-expertise.
La phase d’instruction peut durer plus ou moins longtemps selon que l’affaire qui vous est reprochée est criminelle (crime) ou délictuelle (délit). Le juge d’instruction doit instruire à charge et à décharge.
À l’issue de l’instruction, deux options sont possibles :
- les charges retenues contre vous sont suffisantes et le juge d’instruction émet une ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale compétente qui sera chargée de vous juger,
- le juge d’instruction émet une ordonnance de non-lieu lorsque, par exemple, les faits qui vous sont reprochés ne sont pas établis ou pas suffisamment caractérisés.
L’ordonnance de non-lieu est également rendue lorsque :
- les faits allégués ne relèvent pas d’une loi répressive,
- la prescription est acquise
- l’auteur n’a pas pu être identifié
- la mise en examen est pénalement irresponsable ou éteinte
- il existe une amnistie.
Dans le cadre de l’instruction, la Chambre de l’instruction intervient également : il s’agit d’une formation de jugement de la Cour d'appel (une juridiction de second degré) compétente pour juger les recours formés contre les décisions des juges d’instruction et des juges des libertés et de la détention (par exemple : la Chambre de l’instruction statue sur l’ordonnance refusant une mise en liberté rendue par le JLD).
Il est utile de préciser que le juge d’instruction (ayant instruit votre affaire) ne peut pas vous juger devant la juridiction de jugement (Tribunal correctionnel, Cour d’assises).
Le juge d’instruction n’est pas compétent pour statuer sur votre placement en détention provisoire ou sur son prolongement : ces fonctions sont dévolues au Juge des Libertés et de la Détention ou « JLD ».
Le juge d’instruction constitue le premier degré de l’instruction. Au second degré, il s’agit de la Chambre de l’instruction qui est compétente. Cette dernière statue sur les recours formés contre les ordonnances des juges d’instruction et contre les décisions du juge des libertés et de la détention.
Que vous soyez placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, Me NESSAH, avocate pénaliste, vous assiste pendant toute l’instruction de votre affaire, d’une part en vous informant en temps réel de l’évolution de votre dossier et, d’autre part, en effectuant les diverses demandes d’actes ou de mise en liberté dans votre intérêt.
LA COUR D’ASSISES
En droit pénal, la Cour d’assises est compétente pour juger les majeurs accusés de crimes de droit commun. En principe, les audiences devant la Cour d’assises sont publiques, sauf décision contraire de la Cour ou demande de la victime. Dans ce cas spécifique, l’audience se tient alors « à huis clos » (sans la présence du public).
La Cour d’assises des mineurs juge les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans.
Il convient de souligner que :
- Devant la Cour d’assises, la personne mise en cause est « accusée » tandis qu’au Tribunal correctionnel elle est qualifiée de « prévenue »,
- La personne ayant tenté de commettre un crime ou complice d’un crime comparait également devant la Cour d’assises.
- Le vol avec violence ou « braquage » est également jugé devant une Cour d’assises, même si l’arme utilisée pour commettre l’infraction est factice
- Le trafic de stupéfiants commis dans une bande organisée est considéré comme un crime même s’il n’est pas systématiquement jugé devant la Cour d’assises.
- Les crimes terroristes ou militaires sont jugés par une cour d’assises spéciale composée uniquement de magistrats professionnels
- L’accusé doit être assisté d’un avocat.
Composition de la Cour d’assises :
Elle est composée d’un président (magistrat) et de deux assesseurs (également magistrats), d’un greffier et du jury : il s’agit de 6 personnes appelées jurés, citoyens ordinaires. L’accusé et le Procureur de la République peuvent récuser (refuser) les jurés.
Chaque juré prête serment, écoute les débats sans intervenir et sans avoir eu communication préalable du dossier.
Déroulement du procès d’assises :
1. Le président de la Cour d’assises, conformément à l’acte d’accusation, expose à l’accusé les faits qui lui sont reprochés ainsi que les pièces à charge et à décharge, puis il interroge l’accusé et procède à toutes les auditions (témoins, experts, victimes, etc.).
2. Ensuite, l’avocat de la victime plaide si celle-ci a formé une action civile afin de réclamer la reconnaissance de son préjudice et la réparation.
3. Puis viennent les réquisitions de l’avocat général (représentant les intérêts de la société).
4. Puis c’est l’avocat de l’accusé qui plaide. Comme devant le Tribunal correctionnel, l’accusé a toujours la parole en dernier ressort.
5. Ensuite, les juges et les jurés se retirent pour délibérer (délibération secrète) en deux temps :
- Une délibération sur la culpabilité où la majorité de 6 voix est nécessaire pour toute condamnation,
- Une délibération sur la peine si une condamnation a été prononcée.
1. La décision de la Cour d’assises est prononcée en audience publique et est motivée.
2. L’accusé est alors acquitté (et remis en liberté) ou condamné.
L’accusé, le Procureur de la République ou la victime disposent de 10 jours pour interjeter appel de la décision de la Cour d’assises. L’affaire sera alors rejugée devant la Cour d’assises d’appel où 9 jurés siègent au lieu de 6 (sauf si seul le demandeur civil interjette appel).
Il est également possible d’exercer un pourvoi en cassation contre cette décision de la Cour d’assises d’appel afin que l’affaire soit à nouveau jugée.
COMPARUTION SUR RECONNAISSANCE PRÉALABLE DE CULPABILITÉ
En droit pénal, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou « CRPC » est une transposition de la « plaidoirie de culpabilité à l’américaine ». Son objectif est de désengorger les Tribunaux correctionnels lorsque le prévenu a reconnu les faits lors de sa garde à vue.
Cette procédure est réservée aux infractions mineures et aux personnes dont le casier judiciaire comporte peu ou pas de condamnations.
Il est à noter que dans le cadre de cette procédure, la présence de l’avocat est obligatoire.
L’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se déroule en 2 phases distinctes :
1. Le prévenu comparaît avec son avocat devant le Procureur de la République qui, après avoir vérifié son identité et sa reconnaissance des faits, propose une peine. Après en avoir discuté avec son avocat, le prévenu comparaît ensuite devant un magistrat.
2. Le magistrat demande au prévenu – toujours assisté de son avocat – s’il accepte la peine « proposée par le Procureur ». Le magistrat dispose alors de plusieurs options :
- Dans la plupart des cas, la peine proposée est acceptée et le magistrat valide la peine,
- Le magistrat refuse de valider la peine ou la peine proposée n’est pas acceptée par le prévenu, et le magistrat ne valide pas. L’affaire est alors renvoyée devant le Tribunal correctionnel,
- Si le prévenu ne répond pas à la convocation à l’audience de « CRPC », il sera alors jugé à une autre date devant le Tribunal correctionnel.
Me NESSAH, avocate pénaliste, vous assiste tout au long de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité afin de vous conseiller au mieux sur les choix qui s’offrent à vous.
LA COMPOSITION PÉNALE
Cette procédure permet au Procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures à une personne qui reconnaît avoir commis certaines infractions ou contraventions. Elle peut être appliquée aux mineurs âgés de plus de 13 ans lorsque cela semble approprié à la personnalité de la personne concernée et sous certaines conditions spécifiques.
La procédure de composition pénale est applicable à toutes les contraventions et délits punissables d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans.
Les infractions concernées sont notamment :
- violences entraînant une incapacité de travail,
- menaces, appels téléphoniques malveillants,
- abandon de famille, entrave à l’exercice de l’autorité parentale,
- vol simple, escroquerie, dissimulation,
- port d’arme illégal,
- appropriation frauduleuse de gage, objet saisi,
- détruction, dégradation, détérioration,
- menaces de destruction, fausses alertes,
- injures envers une personne chargée d’une mission de service public,
- maltraitance animale,
- usage illicite de stupéfiants ou infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
USAGE ILLICITE DE STUPÉFIANTS OU INFRACTION DE CONDUITE SOUS L’EMPIRE D’UN ÉTAT ALCOOLIQUE.
La composition pénale n’est pas applicable aux infractions d’homicide involontaire, aux délits de presse et aux infractions politiques.
Quelques exemples de mesures proposées :
La composition pénale avec amende
Le Procureur de la République peut proposer le paiement d’une amende au Trésor public dont le montant ne peut excéder celui de l’amende encourue dans le texte en question.
En droit pénal, le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et charges de la personne.
Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le Procureur sur une durée maximale d’un an.
Autres mesures pouvant être proposées :
Le Procureur peut proposer à l’auteur de l’infraction d’effectuer, au profit de la collectivité, des travaux non rémunérés d’une durée maximale de 72 heures dans un délai qui ne peut excéder 6 mois.
Le Procureur peut également proposer :
un stage ou une formation dans une structure de santé, sociale ou professionnelle, pour une durée maximale de 3 mois et dans un délai ne pouvant excéder 18 mois,
un stage de citoyenneté,
la confiscation au profit de l’État de la chose utilisée ou destinée à commettre l’infraction ou en étant le produit,
la remise au greffe de la Haute Cour du permis de chasse ou du permis de conduire pour une durée maximale de 6 mois.
Dans tous les cas, si la victime est identifiée, le Procureur de la République doit proposer à l’auteur de réparer le dommage causé par l’infraction dans un délai maximum de 6 mois. Il informe la victime de cette proposition.
Exemples d’actions proposées pour les contraventions :
Ce sont les mêmes que celles proposées pour les délits, mais dans des délais réduits.
Le Procureur de la République peut proposer les mesures suivantes pour les contraventions de 5e classe :
- remise du permis de conduire ou du permis de chasse pour une durée maximale de 3 mois
- travaux non rémunérés d’une durée maximale de 30 heures à réaliser dans un délai de 3 mois.
Dans tous les cas, il peut aussi proposer :
- une amende dont le montant ne peut excéder le montant maximal de l’amende encourue,
- un stage de citoyenneté ou une formation dans un service ou établissement de santé, social ou professionnel.
LA PROCÉDURE
La proposition de composition pénale
Le Procureur de la République peut proposer une composition pénale à l’auteur d’une infraction tant que l’action publique n’a pas été engagée.
Si la composition pénale est notifiée à l’auteur par un officier de police judiciaire, elle doit faire l’objet d’une décision écrite signée par le Procureur précisant la nature et le nombre de mesures proposées.
La personne mise en cause est informée qu’elle peut se faire assister d’un avocat avant d’accepter la proposition du Procureur. L’accord est constaté dans un procès-verbal dont une copie est envoyée à l’intéressé.
L’acceptation de la composition pénale
Si la composition pénale est acceptée, le Procureur de la République saisit le président du tribunal (infractions) ou le magistrat (contraventions) pour valider cette composition pénale. L’auteur et, le cas échéant, la victime en sont informés.
Le magistrat peut également procéder à l’audition de ces personnes, assistées si nécessaire de leur avocat.
Si le magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont exécutées.
Si le magistrat ne valide pas la composition, la proposition devient caduque. Cette décision, notifiée à l’auteur et à la victime, n’est pas susceptible d’appel.
Refus ou inexécution de la composition pénale
Si l’auteur n’accepte pas la composition pénale ou s’il n’exécute pas intégralement les mesures décidées après avoir donné son accord, le Procureur de la République engage des poursuites devant les juridictions pénales.
En cas de condamnation, il est tenu compte, le cas échéant, des travaux déjà effectués et des sommes versées à la victime.
Cependant, la victime conserve son droit de demander réparation devant le tribunal pénal. Elle peut également demander, compte tenu de l’ordonnance de validation, la récupération, par voie de procédure d’injonction de payer, des sommes que l’auteur s’est engagé à lui verser.
LE CAS PARTICULIER DES MINEURS ÂGÉS DE 13 ANS OU PLUS
Lorsque l’auteur est un mineur d’au moins 13 ans, la procédure de composition pénale obéit à des règles spécifiques.
Le Procureur de la République doit préalablement consulter le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent avant de recourir à cette procédure.
La proposition du Procureur doit ensuite être faite au mineur et à ses représentants légaux. Leur accord doit être recueilli en présence d’un avocat.
La composition pénale est validée par le juge des enfants. Il peut, soit d’office, soit à leur demande, entendre le mineur ou ses représentants légaux.
Enfin, la décision du juge des enfants est notifiée à l’auteur et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.
Les mesures suivantes peuvent être proposées au mineur dans le cadre de la composition pénale
- suivi d’un stage de sensibilisation civique,
- assiduité scolaire ou formation professionnelle régulière,
- respect d’une décision du juge de placement en établissement ou d’un établissement public ou privé d’enseignement ou de formation professionnelle habilité,
- consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue,
- réalisation d’un dispositif de mesure d’activité de jour
LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS
En droit pénal, la délinquance juvénile dispose de magistrats et de juridictions propres : les juges des enfants et le tribunal pour enfants ainsi que la cour d’assises des mineurs.
Des dispositions répressives et protectrices spécifiques s’appliquent également aux mineurs auteurs d’infractions. L’ordonnance du 2 février 1945, dont le principe est notamment que la peine encourue par un mineur est au maximum égale à la moitié de la peine encourue par un majeur : c’est le principe de « l’excuse de minorité » (qui peut être écarté en cas de récidive).
Il est utile de préciser que certaines affaires sont parfois jugées directement dans les chambres des juges des enfants et non au tribunal pour enfants : ces audiences sont appelées « audience en chambre du conseil » ou « audience de cabinet ».
Le tribunal pour enfants
Le tribunal pour enfants est composé d’un président, de deux assesseurs (ayant manifesté un intérêt pour les enfants), d’un greffier. Le procureur représente les intérêts de la société.
Les audiences du tribunal pour enfants se tiennent à huis clos : c’est-à-dire sans la présence du public. Sont entendus lors de ces audiences : les représentants légaux (généralement les parents du mineur) et, le cas échéant, les éducateurs du mineur.
En général, le tribunal pour enfants statue en matière pénale (pour des infractions comme le vol), mais il se peut également qu’il statue en matière criminelle (pour des crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans au moment des faits).
La cour d’assises des mineurs
La cour d’assises des mineurs est par ailleurs une juridiction compétente pour les mineurs : elle est compétente lorsque les crimes ont été commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans au moment des faits. Elle est composée de 3 magistrats, d’un jury populaire et d’un greffier de la cour d’assises. Les intérêts de la société sont assurés par le procureur général ou par un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs.
Outre le droit pénal, les juges des enfants sont également compétents en matière d’aide éducative : cela concerne toutes les mesures susceptibles d’être prises par le juge des enfants lorsque le mineur se trouve notamment en situation de danger.
Me NESSAH, avocate pénaliste, assiste les mineurs tant dans le cadre des audiences d’aide éducative que des procédures pénales les concernant, depuis leur placement en garde à vue jusqu’à leur comparution devant les juridictions spécialisées des mineurs.
Mesures éducatives ou sanctions et peines
En droit pénal, les mesures éducatives ou sanctions et peines sont décidées au cas par cas par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs.
Elles doivent viser la remise sur le droit chemin et le redressement moral du mineur.
Mesures, sanctions éducatives et peines selon l’âge du mineur :
- mineur capable de discernement de moins de 10 ans : certaines mesures éducatives peuvent être ordonnées (retour auprès des parents, placement, mise sous protection judiciaire, réparation, probation, mesure d’activité de jour),
- mineur âgé de 10 à 13 ans : ne peut faire l’objet que de mesures éducatives et sanctions éducatives
- mineur de plus de 13 ans : des mesures éducatives et sanctions peuvent être ordonnées, ainsi qu’une peine si les circonstances et la personnalité du mineur le justifient.
En droit pénal, la peine ne peut dépasser la moitié de la peine maximale encourue par les majeurs pour tous les mineurs de moins de 16 ans au moment des faits. Cette réduction de peine n’est pas automatique pour les mineurs de plus de 16 ans, le tribunal peut décider de l’écarter, et la loi prévoit qu’elle ne s’applique pas à certains mineurs récidivistes de violence.