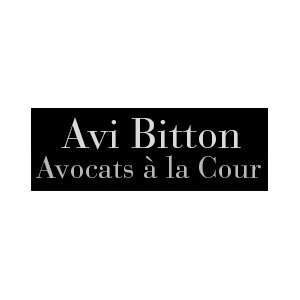Cabinet d’avocats anglophone – assistance juridique en France
Nos avocats anglophones sont spécialisés en droit français et en droit international. Nous conseillons avec succès des entreprises anglaises, américaines et françaises de taille moyenne et importante sur les questions juridiques. Cependant, notre clientèle comprend également des particuliers issus de pays anglophones comme les États-Unis, l’Angleterre et l’Australie.
Le principal objectif de notre cabinet d’avocats à Paris est d’apporter un soutien global à nos clients anglophones ayant besoin d’une assistance juridique en France. Nos avocats anglophones sont inscrits au barreau français et exercent avec succès en tant qu’avocats en France.
En tant que cabinet franco-anglais international doté d’une équipe jeune, motivée et engagée, nous visons à fournir des conseils juridiques de manière nouvelle, moderne et conviviale pour le client. Nos avocats anglophones à Paris ont brillamment achevé leurs études de droit en France et bénéficient également de plusieurs années d’expérience professionnelle à l’étranger. De plus, nos avocats anglophones ont tous exercé auparavant au sein de cabinets internationaux en France. Nos avocats anglophones en France disposent d’au moins dix ans d’expérience professionnelle.
À propos de Alaris Avocats
Fondé en 2005
50 personnes dans l'équipe
Domaines de pratique
Langues parlées
Gratuit • Anonyme • Avocats Experts
Besoin d'un accompagnement juridique personnalisé ?
Mettez-vous en relation avec des avocats expérimentés près de chez vous pour obtenir un conseil adapté à votre situation.
Aucune obligation d'embauche. Service 100% gratuit.
Domaines de pratique
Immobilier
Droit de la construction en France
Le droit de la construction en France comprend un ensemble de dispositions juridiques très spécifiques. Les maîtres d’œuvre et les sous-traitants sont fortement protégés en France, ce qui entraîne un renversement de la charge de la preuve. Selon le droit français de la construction, en cas de litige, les parties impliquées dans un projet de construction doivent être en mesure de prouver au client que les dispositions légales de construction et leur devoir de conseil ont été respectés pendant toute la durée du projet. En cas de projets de construction de grande envergure, cela signifie que les entreprises présentes sur les chantiers doivent satisfaire à cette charge de la preuve par écrit et par lettre recommandée, afin de disposer de la correspondance nécessaire en cas de litige.
Droit de la construction pour les sous-traitants en France
Les sous-traitants sont légalement protégés par le droit français de la construction. Les sous-traitants doivent être enregistrés par écrit et approuvés par les maîtres d’ouvrage. De plus, des contrats de sous-traitance écrits doivent être conclus.
Dans le cas de contrats de construction privés, les paiements au sous-traitant sont sécurisés par une garantie de paiement (loi n° 75-1347 du 31 décembre 1975). Selon le droit français de la construction, le sous-traitant ne peut renoncer à cette protection. Tant que la garantie de paiement n’a pas été fournie, le contrat de sous-traitance est inefficace et peut être résilié unilatéralement par le sous-traitant. Si aucune garantie de paiement n’a été mise en place, le sous-traitant peut, sur demande, suspendre ses travaux et engager une action en dommages et intérêts. En outre, le prix forfaitaire stipulé contractuellement cesse de s’appliquer.
Dans le cas de marchés publics de travaux, une garantie de paiement n’est pas requise. Selon le droit public de la construction en France, le maître d’ouvrage est tenu de payer le sous-traitant de 1er rang.
Les fournisseurs sont exemptés de cette obligation. Cependant, la distinction entre fournisseurs et sous-traitants n’est pas toujours facile à établir.
Droit de la construction pour les constructeurs en France
Selon le droit français de la construction, l’obligation de fournir une garantie de paiement existe non seulement entre l’entrepreneur général et le sous-traitant, mais également entre le client et l’entrepreneur général ou l’architecte et/ou le bureau d’études. Selon l’art. 1799-1 du Code civil français, le client doit fournir à l’entrepreneur une garantie de paiement pour la totalité du montant du contrat. Si cette garantie n’est pas mise en place, l’entrepreneur peut suspendre ses travaux.
Vous avez des questions sur le droit français de la construction ?
Nous sommes ravis de vous assister !
Contact
Garanties en droit de la construction français
Il existe trois garanties légales différentes en France : Garantie de Parfait achèvement, Garantie Biennale et Garantie Décennale.
Toutes les parties impliquées dans les projets de construction, telles que les entreprises de construction, les architectes, les maîtres d’ouvrage et les bureaux d’études, sont concernées par les dispositions françaises relatives aux garanties.
Tout d’abord, la loi française prévoit une période de garantie obligatoire d’un an, la dite Garantie de Parfait achèvement. En vertu de cette garantie légale, les parties impliquées dans un projet de construction doivent, à leurs frais, remédier à tous les désordres expressément mentionnés dans le procès-verbal de réception ainsi qu’à tous les désordres cachés intervenant − quelle qu’en soit la nature − qui ne sont pas de simples traces d’usure.
Pendant deux années suivant la réception, la garantie dite biennale s’applique. Selon cette garantie légale, l’entreprise ayant réalisé les travaux de construction s’engage à réparer ou remplacer, à ses frais, tout équipement ne fonctionnant pas correctement. L’équipement est ici défini comme des éléments de construction pouvant être détachés du bâtiment sans l’endommager (par ex. : volets roulants).
En France, il existe également la dite Garantie Décennale, c’est-à-dire la garantie décennale. Selon cette garantie française, le constructeur est responsable des dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Assurance de garantie décennale
La garantie décennale, la Garantie Décennale, oblige les constructeurs en France à souscrire une assurance pour l’ensemble de cette période. L’assurance dite Décennale est une assurance obligatoire qui concerne également tous les entrepreneurs non français ainsi que les architectes exerçant en France.
Il n’est pas toujours facile pour les entreprises de construction étrangères de trouver un « assureur Décennal ». Il peut s’écouler entre 6 et 8 mois pour qu’une entreprise de construction étrangère obtienne une telle assurance.
Si plusieurs chantiers sont réalisés en France, le coût de l’assurance est calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise. Ici, une éventuelle insolvabilité de l’entreprise n’affecte en rien l’obligation décennale de l’assureur.
En complément de l’assurance Décennale, le maître d’ouvrage doit souscrire une assurance dommages-ouvrage, la dite Dommage-ouvrage. Cette assurance couvre les dommages futurs intervenant après la réception. L’assurance dommages-ouvrage permet au maître d’ouvrage d’être rapidement indemnisé financièrement. Cela signifie que le maître d’ouvrage n’a pas à attendre une décision judiciaire et l’intervention d’expertises pour statuer sur les responsabilités respectives.
Baux commerciaux
Les baux commerciaux en France sont des baux portant sur des locaux dans lesquels une activité commerciale ou industrielle est exercée. Il est obligatoire que les locaux soient utilisés pour l’activité commerciale. Le contrat de bail commercial est régi par le droit commercial français et fait partie du dit Fonds de Commerce.
Un bail commercial est généralement conclu pour une durée minimale de 9 ans. Toutefois, le bailleur et le preneur peuvent également conclure un contrat pour une durée plus longue. Il n’est pas possible de conclure un contrat de bail commercial pour une durée illimitée.
Le bailleur doit verser au preneur une indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail commercial. Le preneur peut résilier après 3 ou 6 ans de contrat. En revanche, le bailleur ne peut résilier qu’en cas exceptionnel. Pour résilier le bail commercial, le preneur doit notifier par écrit au bailleur sa volonté de résilier par lettre recommandée au moins 6 mois avant la fin de la période de 3 ou 6 ans.
Droit de la construction en France - avocats spécialistes d’Alaris Law
Les avocats d’Alaris Law conseillent des entreprises de construction françaises, anglaises et internationales, des sous-traitants, maîtres d’ouvrage, promoteurs immobiliers et/ou architectes sur le droit français de la construction. En tant qu’avocats spécialisés en droit français de la construction, nous pouvons vous assister avant le démarrage des opérations de construction, lors des négociations contractuelles et dans la rédaction des contrats. Les avocats d’Alaris possèdent une connaissance approfondie des dispositions légales en France et des réglementations applicables localement. Nous vous représentons dans les procédures d’expertise judiciaires ou extrajudiciaires ainsi que dans les procédures devant les juridictions étatiques françaises.
En tant qu’avocats spécialisés en droit public et privé de la construction en France, nous vous accompagnons également dans les contrats de construction et les cahiers des charges. Nos avocats spécialisés accompagnent l’exécution de votre projet de construction et vous déchargent de la gestion d’un grand nombre d’assurances et de garanties bancaires.
Banque et finance
Énergie, environnement et ESG
Affaires
Droit des sociétés
Lors de la création d’une société en France, les fondateurs doivent choisir la forme de la future personne morale. Le droit des sociétés français propose diverses structures juridiques. Ce choix est déterminant pour le statut juridique futur ainsi que pour les aspects fiscaux, administratifs et du droit du travail. La structure choisie peut être modifiée à tout moment par une résolution des associés de la société.
En France, la constitution d’une société ne nécessite pas l’intervention d’un notaire. En tant qu’avocats spécialisés en droit des sociétés en France, nous pouvons nous charger de la création de votre société et vous accompagner dans toutes les questions juridiques connexes.
Vous avez des questions sur le droit du travail français ?
Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller !
Contact
Types d’entités juridiques en France
Vous trouverez ci-dessous une brève présentation des différentes entités juridiques en France :
La société en nom collectif Société en nom collectif (SNC)
La Société en nom collectif (SNC) est une forme sociétaire dans laquelle les associés (au moins 2) ont la qualité de commerçants et sont solidairement responsables des dettes sociales. Aucun capital minimum n’est exigé.
La société anonyme Société anonyme (SA)
La Société anonyme (SA) est une société de capitaux réunissant au moins 2 actionnaires. Cette entité française peut être administrée par un conseil d’administration présidé par un président ou par un directoire et un conseil de surveillance.
La société à responsabilité limitée Société à responsabilité limitée (SARL)
La Société à responsabilité limitée (SARL) est une entité juridique dans laquelle les associés (entre 2 et 100) ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports. Aucun capital minimum n’est requis en France.
Autres entités juridiques françaises :
- Lorsqu’il n’y a qu’un seul associé, la société est une Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).
- Lorsque les associés exercent une profession libérale réglementée (ex. médecins ou avocats), la société est une Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL). Lorsqu’une société anonyme d’exercice libéral doit être constituée, elle prend la forme juridique d’une Société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA).
- Une Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) peut également être constituée en tant que société par actions simplifiée (voir ci-dessous).
La société par actions simplifiée Société par actions simplifiée (SAS)
La Société par actions simplifiée (SAS) est une forme juridique très appréciée en France. Il s’agit d’une société de capitaux simplifiée dans laquelle les actionnaires (au moins 2) ne sont responsables des dettes sociales qu’à hauteur de leurs apports (comme dans la SARL). Aucun capital minimum n’est requis. Par rapport à la SARL, les fondateurs disposent d’une grande liberté dans la rédaction des statuts. Lorsqu’il n’y a qu’un seul actionnaire, l’entité juridique est une Société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU).
Création d’une société en France
En France, les sociétés sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés (RCS) du tribunal de commerce compétent. La compétence est déterminée par le lieu du siège social. L’immatriculation prend environ deux semaines. Sans immatriculation, la société n’a pas de personnalité juridique et ne peut par conséquent agir dans ses relations extérieures.
De plus, il est obligatoire en France d’ouvrir un compte bancaire professionnel dans lequel au moins la moitié du capital social doit être versée. Les banques françaises exigent généralement la présence du dirigeant futur lors de l’ouverture du compte. Par ailleurs, la société doit disposer d’un siège social, qui peut être un local loué ou simplement une boîte postale.
Lorsqu’une société est constituée en France, les personnes détenant plus de 25 % du capital social ou plus de 25 % des droits de vote doivent être déclarées au registre. Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la société reçoit un « Kbis », soit l’extrait Kbis. L’extrait du registre du commerce, les statuts et les résolutions des associés peuvent être demandés et consultés sur le site officiel du registre : www.infogreffe.fr
Conseillers fiscaux et commissaires aux comptes en France
Toutes les sociétés constituées en France sont soumises à des obligations comptables. Par exemple, elles doivent déposer annuellement leurs comptes auprès du greffe. De nombreuses sociétés confient leurs obligations comptables à des conseillers fiscaux externes lorsqu’elles ne disposent pas d’un service comptable interne. Cependant, il n’existe aucune obligation légale de nommer un conseiller fiscal.
La nomination d’un commissaire aux comptes se distingue de celle du conseiller fiscal. L’obligation légale de nommer un commissaire aux comptes en France pour une durée minimale de 6 ans dépend du total du bilan, du chiffre d’affaires et du nombre de salariés. Par exemple, pour une SARL, la nomination d’un commissaire aux comptes est obligatoire si deux des trois seuils suivants sont dépassés :
- 4 000 000 € de total de bilan
- 8 000 000 € de chiffre d’affaires hors TVA
- 50 salariés
Un commissaire aux comptes peut également être nommé à la demande d’associés représentant au moins 1/3 du capital social. Le défaut de nomination malgré le dépassement des seuils est puni d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 30 000 €.
Responsabilité des dirigeants en France
Lors de la création d’une société en France et pendant toute la durée de la fonction du dirigeant, celui-ci est civilement et pénalement responsable et répond des difficultés fiscales en cas de mauvaise gestion. Cela s’applique tant en interne qu’en externe. Une faute du dirigeant résulte d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, qu’il s’agisse d’une action ou d’une omission.
La condition essentielle est l’existence d’une erreur du dirigeant causant un préjudice (par exemple, le non-respect des statuts ou un comportement déloyal envers la société). Dans les relations externes, la faute du dirigeant implique que la société elle-même est engagée envers les tiers, sauf si la mauvaise foi de ce dernier est démontrée.
En cas d’insolvabilité, l’administrateur judiciaire peut, dans certaines circonstances, mettre en cause la responsabilité personnelle du dirigeant pour faute. Le dirigeant est alors responsable sur son patrimoine personnel. Même pour des associés dont la responsabilité est limitée au capital social, cette limite peut être dépassée dans certaines conditions.
Procédures d’insolvabilité en France
Une société est juridiquement insolvable lorsque ses actifs disponibles ne suffisent plus à couvrir ses dettes. Dans ce cas, une procédure d’insolvabilité, le Dépôt de bilan, doit être déposée auprès du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. La requête en insolvabilité doit être déposée devant le tribunal compétent dans un délai maximal de 45 jours à compter de la date d’insolvabilité. Tout manquement peut être considéré comme un retard de dépôt de bilan.
Le droit français propose différentes procédures d’insolvabilité, selon que la société peut être restructurée (redressement ou liquidation). Dans certaines circonstances, il est également possible de solliciter la protection du juge en cas de difficultés financières sans déposer de bilan (Procédure de sauvegarde ou conciliation).
Nonobstant ce qui précède, une société peut être dissoute à tout moment par une résolution des associés. Si la société mère à l’étranger est l’unique associée de la filiale française, une transmission universelle de patrimoine, dite TUP, c’est-à-dire une « fusion », intervient automatiquement avec la dissolution de la filiale.
Conclusion : Droit des sociétés France
La création d’une société en France implique de nombreux aspects juridiques à prendre en compte, depuis le choix de la structure adaptée jusqu’à la constitution proprement dite, en passant par les questions fiscales et de responsabilité. En tant qu’avocats spécialisés en droit des sociétés françaises, nous vous accompagnons et vous conseillons lors de la création et de la vie de votre société en France.
Droit des sociétés et commercial
Emploi et travail
Droit du travail en France
Le droit du travail en France protège les salariés dès le début de leur relation de travail, pendant toute la durée du contrat de travail et jusqu’à sa rupture.
Le droit du travail français est généralement plus favorable aux salariés qu’aux employeurs. En France, la législation applicable à la relation de travail entre l’employeur et le salarié découle essentiellement du Code du travail français et de diverses conventions collectives. En cas de litige juridique, la jurisprudence française est principalement déterminante. Il existe d’importantes divergences entre les décisions rendues par les conseils de prud’hommes.
En France, l’Inspection du travail est chargée de veiller au respect des dispositions du droit du travail, tant dans les lieux de travail qu’en dehors (par exemple les chantiers).
Vous avez des questions sur le droit du travail français ?
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !
Contactez-nous
Contrats de travail en France : CDI et CDD
En droit du travail français, plusieurs types de contrats de travail coexistent. Le droit français prévoit le contrat à durée indéterminée (CDI), le contrat à durée déterminée sous certaines conditions (CDD), ainsi que le contrat de travail temporaire. Par ailleurs, dans certains secteurs d’activité, il est possible de conclure des contrats de projet qui prennent fin à l’achèvement du projet pour lequel ils ont été conclus, sans versement de la prime de 10 % prévue en cas de rupture d’un CDD (par exemple pour les marchés de construction après la réception de l’ouvrage).
CDD – le contrat à durée déterminée en France
Le CDD – Contrat à Durée Déterminée est un contrat de travail à durée limitée. Comme son nom l’indique, sa durée est limitée dans le temps. Cette durée limitée doit être explicitement mentionnée dans le contrat de travail, de même que toutes les autres clauses particulières obligatoires. Les possibilités juridiques de conclure un CDD sont strictement encadrées et impératives en droit du travail français.
Un CDD qui se poursuit au-delà de son terme devient automatiquement un CDI. Il convient donc d’être vigilant lors de la confirmation formelle de la fin d’un CDD en France.
CDI – le contrat de travail à durée indéterminée en France
Le CDI – Contrat à Durée Indéterminée est un contrat de travail à durée indéterminée. Sa durée est illimitée. Un CDI ne peut être rompu que d’un commun accord ou à l’issue d’une procédure de licenciement. En France, le CDI constitue la relation contractuelle normale de travail prévue par l’article L1221-2 du Code du travail. Les droits et obligations découlant du CDI sont définis par le droit du travail français.
Durée du travail en France
Outre les contrats de travail, le Code du travail français régit également la durée du travail. Il est impératif de respecter ces dispositions ou d’établir des contrats de travail forfaitaires pour les cadres. Dans le cadre d’une relation de travail en cours, il convient de veiller à ne pas dépasser le nombre d’heures autorisé, car l’employeur a une obligation de diligence envers ses salariés.
Selon le droit français de la durée du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours consécutifs par semaine. En principe, le travail dominical est interdit. Toutefois, dans certains cas, le repos dominical ne peut être respecté. Dans ce cas, le jour de repos peut être reporté à un autre jour que le dimanche ou être réduit dans certaines conditions, qui varient selon les dérogations prévues par la loi.
La durée légale du travail hebdomadaire est fixée à au moins 35 heures par semaine. Toutefois, des dérogations sont possibles, notamment des contrats de 39 heures par semaine ou des contrats forfaitaires pour les cadres, dans lesquels les heures supplémentaires ne sont pas rémunérées – ce qui constitue plus une pratique courante qu’une exception.
Chaque salarié a droit à au moins deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois et par an (soit cinq semaines après un an d’ancienneté). Certaines absences du salarié sont prises en compte dans le calcul des jours de congé. Certaines conventions collectives, le contrat de travail ou un usage professionnel peuvent prévoir une durée de congé plus favorable au salarié que celle prévue par la loi.
Licenciements en France
En France, il doit exister un motif réel et sérieux pour procéder au licenciement d’un salarié, qu’il soit d’ordre personnel ou économique. Outre les motifs de licenciement, une procédure rigoureuse doit également être respectée. En complément du préavis en France, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable dans les délais.
La lettre de licenciement doit également exposer les motifs du licenciement. Outre le licenciement classique, il existe la possibilité alternative de mettre fin au contrat de travail par accord entre les parties dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Les licenciements collectifs en France sont également très formalisés et la procédure applicable dépend du nombre de salariés concernés et de la taille de l’entreprise.
Conclusion : le droit du travail français
En droit du travail français, les dispositions impératives doivent être mentionnées dans le contrat de travail, qu’il soit à durée déterminée, indéterminée ou pour une durée limitée. La durée du travail est réglementée par les dispositions légales françaises. Il est important de connaître les exigences fondamentales du droit du travail français, même en cas de détachement. Ainsi, la rémunération ne doit pas être inférieure au salaire minimum (le SMIC) et la durée légale de 35 heures doit être respectée. En cas de rupture, il faut veiller à la procédure applicable (préavis ou rupture conventionnelle), au préavis légal français et au montant de l’indemnité de licenciement. Le droit du travail français est plutôt protecteur envers les salariés.
Des questions sur le droit du travail français ?
Nous sommes ravis de vous aider !
Contactez-nous
Nous vous conseillons en droit du travail en France
Alaris est spécialisé en droit du travail français et vous accompagne également pour toutes les problématiques juridiques internationales en matière de droit du travail. Nous vous conseillons sur :
- les contrats de travail français
- le licenciement
- les sanctions en droit du travail (inspection du travail)
- les ruptures conventionnelles
- le détachement, etc.
Nous vous représentons en droit collectif du travail (droits des comités d’entreprise, élections professionnelles, accords collectifs, etc.) à titre consultatif et/ou devant les juridictions.
Dans les litiges juridiques internationaux complexes et exigeants, vous bénéficierez de notre vaste expérience. Alaris maîtrise les procédures judiciaires et les procédures de règlement amiable devant les juridictions prud’homales françaises et vous accompagne lors des inspections du travail en France.
L’objectif du cabinet Alaris est d’offrir à chaque client un accompagnement juridique et pratique complet – dans tous les domaines du droit du travail et de la sécurité sociale français et international, tant individuel que collectif.
Procès et litiges
Arbitrage
Arbitrage international à Paris | Cabinet Alaris Law Firm
Chambre de commerce internationale de Paris (CCI)
Clause compromissoire dans les contrats commerciaux internationaux
Pour saisir une juridiction en France devant un tribunal arbitral, généralement la Chambre de commerce internationale (CCI) basée à Paris, une clause de compétence contractuelle dans les contrats commerciaux, dite clause compromissoire, est nécessaire.
Les parties peuvent adapter cette clause à leur situation particulière. Par exemple, le Règlement d’arbitrage de la CCI prévoit en principe un arbitre unique. Toutefois, les parties peuvent déroger au nombre d’arbitres (voir aussi art. 1508 Code civil). De même, il peut être souhaitable qu’elles stipulent le lieu et la langue de l’arbitrage et déterminent la loi applicable au litige (voir également l’article 1509 Code civil).
Le Règlement d’arbitrage de la CCI n’impose donc aucune limite aux parties quant au choix du lieu et de la langue de l’arbitrage ainsi que de la loi applicable au contrat.
Le tribunal arbitral est par conséquent soumis aux règles énoncées dans les contrats commerciaux eux-mêmes, souvent par renvoi aux règles d’arbitrage. Pour la Chambre de commerce internationale (CCI), il s’agirait du Règlement d’arbitrage 2017 : iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/
Lorsqu’une clause compromissoire est insérée dans le contrat commercial, les juridictions nationales françaises ne sont plus compétentes. Toutefois, la compétence spéciale doit être invoquée par les parties (Cass. 2e civ., 22 nov. 2001, préc. - Cass. 1re civ., 23 janv. 2007, n° 06-11.157 : JurisData n° 2007-037067 ; Rev. arb., 2007, p. 290. - Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 09-12.669 : JurisData n° 2010-051399. - Cass. 1re civ., 14 avr. 2010, n° 09-12.477 : JurisData n° 2010-004059 ; Rev. arb. 2010, p. 495, P. Caillé).
Les juridictions nationales françaises restent exceptionnellement compétentes même lorsqu’une clause compromissoire est stipulée si la Chambre de commerce internationale (CCI) n’a pas encore été désignée et que la clause compromissoire est manifestement nulle ou inapplicable (article 1448 CPC). Ces conditions sont cumulatives.
Par ailleurs, tant que le tribunal arbitral n’a pas encore été désigné, il demeure possible d’engager une procédure devant les juridictions françaises pour des mesures conservatoires efficaces (dites référés) (art. 1449 CPC).
En vertu du principe de la force obligatoire des conventions (article 1165 Code civil), la clause compromissoire n’engage que les parties contractantes et ne lie donc pas les tiers.
La nullité de la clause compromissoire n’affecte pas la validité des autres clauses contractuelles (article 1447 CPC).
Les parties disposent d’une liberté d’adaptation de la clause à leurs circonstances particulières. Par exemple, elles peuvent vouloir fixer le nombre d’arbitres étant donné que le Règlement d’arbitrage de la CCI comporte une présomption en faveur d’un arbitre unique. Il peut également être souhaitable qu’elles déterminent le lieu et la langue de l’arbitrage ainsi que la loi applicable au fond. Le Règlement d’arbitrage de la CCI n’entrave en rien le libre choix des parties quant au lieu et à la langue de l’arbitrage ou à la loi régissant le contrat.
À titre d’exemple, une clause type possible pour la CCI serait : « Tous les différends découlant du présent contrat ou s’y rapportant seront définitivement tranchés selon le Règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit Règlement. »
Un grand avantage de la Chambre de commerce internationale à Paris est que les parties obtiennent rapidement une sentence. Comme indiqué ci-dessus, les parties peuvent elles-mêmes décider de l’arbitre, de la langue et du siège de la procédure ainsi que de la loi applicable. Le principal inconvénient réside cependant dans les frais procéduraux et d’arbitrage très élevés et dans le fait qu’un recours est rarement possible.